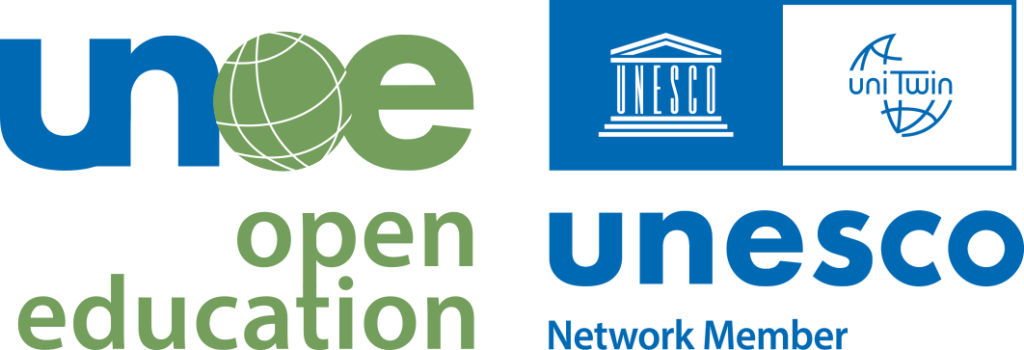3/3. Pourquoi apprendre aujourd’hui ?
Cette question a fait l’objet de discussions croisées entre partenaires du réseau UNOE. Voici la contribution de Fawzi Baroud, l’enseignant du groupe étudiant libanais à Notre Dame University- Louaize.
IA et apprentissage : un débat étudiant interculturel
À une époque où l’intelligence artificielle ne cesse de transformer notre paysage académique, une question fondamentale émerge : « Maintenant que l’IA fonctionne si bien… avons-nous encore besoin d’apprendre ? » Cette interrogation provocante a constitué le point central d’un récent échange académique interculturel entre des étudiant·es français·es de Nantes Université et des étudiant·es libanais·es de l’Université Notre Dame de Louaize.
Le cadre

Le débat a suivi un format innovant. D’abord, les étudiant·es de Nantes Université ont engagé une première discussion autour de la question centrale. Leurs réflexions et arguments ont été documentés et partagés avec leurs homologues libanais·es. Fort·es de ce discours préliminaire, les étudiant·es libanais·es ont préparé des questions ciblées afin d’approfondir la conversation lors d’une réunion ultérieure en visio.
Ce qui en est ressorti est une riche mosaïque de perspectives, cristallisées autour de trois piliers fondamentaux identifiés par les étudiant·es français·es :
- la socialisation,
- la pensée critique,
- et le plaisir d’apprendre.
1er pilier : La socialisation – Les liens humains à l’ère du numérique
Les étudiant·es français·es ont souligné l’importance irremplaçable des dynamiques sociales dans le processus d’apprentissage. Ils ont mis en avant la manière dont les environnements éducatifs traditionnels favorisent la collaboration, l’échange culturel et le développement de compétences interpersonnelles que l’IA ne peut reproduire.
« Apprendre ne se résume pas à acquérir du contenu, » a noté une étudiante nantaise, « mais consiste à créer des expériences partagées et à bâtir des réseaux qui perdurent au-delà de la salle de classe. »
Les étudiant·es libanais·es ont répliqué en observant que les plateformes d’apprentissage assistées par l’IA intègrent de plus en plus des éléments sociaux via des communautés virtuelles et des outils collaboratifs. Toutefois, les deux groupes ont fini par reconnaître que, si la technologie peut faciliter certains types de connexions, les dimensions subtiles de l’interaction humaine restent essentielles au développement éducatif.
2ème pilier : La pensée critique – Au-delà du raisonnement algorithmique
Les échanges les plus animés ont porté sur le thème de la pensée critique. L’analyse des étudiant·es français·es sur les limites de l’IA dans ce domaine s’est révélée particulièrement percutante : « Puisque l’IA est conçue par des humains, elle n’est pas totalement neutre, et lorsqu’on lui pose des questions, elle sélectionne des réponses selon la manière dont son algorithme a été conçu. »
Ils ont soulevé le problème du caractère non sélectif de la collecte d’informations par l’IA : « Les informations fournies par les IA génératives proviennent à la fois de sources vérifiées et de théories infondées». Les étudiant·es libanais·es ont argumenté qu’à une époque où l’information est abondante mais la sagesse rare, la capacité à évaluer, contextualiser et synthétiser l’information devient encore plus cruciale. « L’IA excelle dans la reconnaissance de motifs et le traitement de données, » a souligné un étudiant, « mais peine à exercer le type de jugement contextuel et de raisonnement éthique qui définit l’intelligence humaine ».
Fait intéressant, les étudiant·es se sont globalement accordé·es sur la nécessité pour les institutions éducatives de faire évoluer leurs approches en matière d’enseignement de la pensée critique. Plutôt que de chercher à rivaliser avec les capacités de l’IA, l’éducation devrait les compléter en se concentrant sur les forces cognitives proprement humaines.
3ème pilier : Le plaisir d’apprendre – La motivation intrinsèque
La discussion a pris une tournure plus philosophique en abordant la satisfaction inhérente à l’acquisition du savoir. Les étudiant·es des deux institutions ont reconnu que, même si l’IA peut optimiser l’efficacité de la transmission d’informations, elle ne peut reproduire la joie intrinsèque de la découverte et de la maîtrise.
Les étudiant·es nantais·es ont également noté que l’IA, bien utilisée, pouvait elle-même être source de plaisir :
« Nous avons réalisé que savoir utiliser une IA, en générant la bonne question pour obtenir la réponse souhaitée, c’était aussi amusant. »
Ils ont souligné le potentiel de l’IA pour rendre l’apprentissage plus accessible et plus plaisant, notamment pour des matières perçues comme difficiles ou peu attrayantes dans les cadres éducatifs traditionnels.
Les deux groupes ont également souligné que certaines pratiques d’évaluation nuisent souvent au plaisir d’apprendre, qu’il y ait usage de l’IA ou non : « Le marché du travail et le système scolaire actuel présentent le diplôme comme un label garantissant les connaissances à l’employeur, en faisant une étape obligatoire et une fin à l’apprentissage ».
Points de convergence
Malgré leurs différences académiques et culturelles, les étudiant·es ont trouvé un terrain d’entente sur plusieurs points clés :
- L’avenir de l’éducation adoptera probablement une approche hybride, exploitant l’IA pour la transmission des informations tout en conservant l’intervention humaine pour des expériences d’apprentissage plus profondes.
- La réussite éducative dépendra de plus en plus de l’enseignement de la collaboration avec l’IA plutôt que de la compétition contre elle. L’approche pédagogique devrait évoluer vers l’apprentissage du « comment, pourquoi, et surtout quand utiliser l’IA », car en interdire l’usage hors de l’école est irréaliste.
- Le développement de l’intelligence émotionnelle et des compétences interpersonnelles deviendra encore plus précieux dans un monde saturé d’IA.
Perspectives
Cet échange interculturel n’avait pas pour but de trancher définitivement la question centrale, mais plutôt d’en explorer la complexité sous différents angles. Il en est ressorti une compréhension nuancée, dépassant l’opposition binaire entre apprentissage humain et IA.
Le dialogue entre ces deux groupes d’étudiant·es représente une version miniature des grandes conversations mondiales sur le rôle de l’IA dans l’éducation et le développement humain. Leur échange incarne les qualités mêmes dont ils ont débattu — pensée critique, socialisation significative et plaisir authentique de l’apprentissage collaboratif — tout en ouvrant la voie à une compréhension plus fine de la manière dont l’IA et l’apprentissage humain pourraient coexister et se compléter à l’avenir.